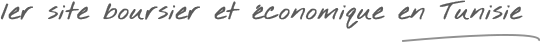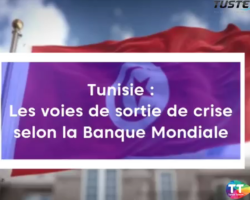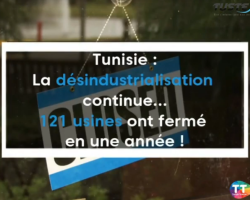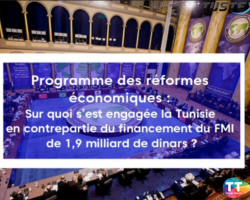Communiqué de presse en date du 16 juin 2003.
« Maghreb Rating, affiliée à l’agence
internationale de notation Fitch Ratings, lève la mise sous surveillance des
notes attribuées à Tunisie
Leasing (TL), Arab
Tunisian Lease (ATL), Compagnie
Internationale de Leasing (CIL), Général
Leasing (GL) et Amen
Lease (AL), et abaisse comme suit les notes de ces sociétés sur l’échelle
de notation nationale:
• TL
: Court Terme = F2; Long Terme = BBB+ avec perspective d’évolution Négative
• ATL
: Court Terme = F2 ; Long Terme = BBB+ avec perspective d’évolution Négative
• CIL
: Court Terme = F3 ; Long Terme = BBB avec perspective d’évolution Négative
• GL
: Court Terme = F3 ; Long Terme = BBB avec perspective d’évolution Négative
• AL
: Court Terme = F3; Long Terme = BBB- avec perspective d’évolution Négative
La conjoncture difficile que traverse la Tunisie a pour
conséquence une fragilisation de son tissu économique et une baisse de la
demande de crédit ayant affecté en 2002 l’ensemble du secteur financier. Les
perspectives pour 2003 restent encore à ce jour incertaines. Ainsi en Mars
2003, Maghreb Rating a placé sous surveillance avec implication négative les
notes des cinq sociétés de leasing sus mentionnées. Une revue complète du
secteur a depuis lors été menée et a abouti à la conclusion que les sociétés
de leasing faisaient face à une nette détérioration de leur environnement opérationnel
: baisse de la demande de crédit, vive concurrence poussant les marges à la
baisse, dégradation de la qualité des actifs, liquidité serrée, difficultés
de refinancement sur le marché obligataire, capitalisation moins robuste
qu’il n’y paraît compte tenu de la faible couverture des actifs classés
par les provisions. Une analyse de la situation intrinsèque de chacune des cinq
sociétés a été également conduite qui a abouti à abaisser les notes des
cinq sociétés de leasing pour les situer dans la catégorie des « BBB » avec
des différenciations reflétant leurs forces et faiblesses respectives. Les
motivations de ces différenciations sont détaillées dans les rapports de
notation de ces sociétés disponibles, sur simple demande auprès de Maghreb
Rating.
La perspective d’évolution négative qui assortit les
notes long terme attribuées aux cinq sociétés de leasing sus mentionnées,
traduit l’opinion de Maghreb Rating quant aux faiblesses structurelles du
secteur du leasing. La ligne de démarcation originelle du marché des sociétés
de leasing tendant à s’estomper, elles subissent la concurrence des banques
qui opèrent de plus en plus sur les mêmes marchés que ces dernières. Le
secteur du leasing se caractérise en outre, par la taille limitée de ses opérateurs
et leur nombre trop important pour un marché somme toute assez restreint, ce
qui conduit inévitablement à une vive concurrence et à une réduction des
marges. En outre, le secteur du leasing a démontré en 2002 sa forte vulnérabilité
face aux retournements de conjoncture et ce, du fait de l’absence de
diversification de ses sources de revenus. D’autre part, le financement des
sociétés de leasing repose principalement sur un marché obligataire dont
l’accès leur est de moins en moins aisé.
TL
et ATL
qui détiennent respectivement des parts de marché de 20% et 13,8%, et se
situent respectivement au premier et quatrième rangs du secteur de par la
taille de leurs actifs, affichent des indicateurs de solvabilité globalement
supérieurs à ceux de leurs pairs.
Tunisie
Leasing : La concurrence a eu un impact négatif sur les marges de TL,
toutefois son orientation marquée sur les financements de véhicules
utilitaires (30% de son encours total de crédit à fin 2002), sa large division
des risques (les 20 plus gros risques de crédit représentent moins de 15% de
ses encours à fin 2002), la gestion avisée de son portefeuille de crédits, sa
politique de provisionnement plus prudente que celle de ses pairs et l’amélioration
des performances de son recouvrement lui ont permis, contrairement au secteur,
d’améliorer la qualité de ses actifs et de ramener à fin 2002 son ratio de
créances classées brutes à 18,5% du total de son portefeuille. Les créances
classées nettes de provisions représentaient à cette même date 61,8% des
fonds propres de TL
contre une moyenne de 112,2% pour le secteur.
Arab
Tunisian Lease : Le résultat net de ATL
s’est inscrit en recul en 2002 sous l’effet d’un ralentissement de sa
production de crédit, d’une baisse de ses marges d’intérêt et de plus
importantes dotations de provisions pour risque. Toutefois, sa rentabilité est
restée supérieure à celle de ses pairs du fait de son positionnement sur le
segment profitable du financement des véhicules utilitaires légers qui représentait
près de 35% de son portefeuille de crédits à fin 2002. ATL
présente une meilleure qualité d’actifs que ses pairs mais celle–ci tend
à se dégrader avec des créances classées brutes représentant 15,1% de ses
encours de crédit à fin 2002. A l’instar de l’ensemble des opérateurs du
secteur, la couverture des créances classées de ATL
par les provisions est faible, 38,4% contre une moyenne de 39% pour le secteur.
Compagnie
Internationale de Leasing : Le portefeuille de crédits de la CIL
a enregistré en 2002 une progression supérieure à la moyenne du secteur, résultant
principalement d’une croissance des financements de biens d’équipement
(26,4% de l’encours global de crédit) et d’opérations immobilières de
taille moyenne (29,5% de l’encours global) alors que les financements de véhicules
utilitaires représentaient moins de 15% de son encours global. Le portefeuille
de créances de la CIL
est relativement concentré avec les 20 plus importants risques représentant
20,7% du portefeuille total à fin 2002. Les créances classées brutes s’élèvent
à 17,2% de l’encours des crédits et les créances classées nettes de
provisions atteignent le niveau relativement élevé de 84% des fonds propres de
la CIL.
Le résultat net a régressé en 2002 conséquemment à un doublement des
dotations aux provisions qui ont atteint 2,9 millions de dinars.
Général
Leasing : GL
est clairement positionnée sur les financements de petits montants (moins de
50.000 dinars). Son portefeuille de crédits est bien diversifié et ses risques
bien divisés (les 20 plus importants risques de crédit représentent 17,3% de
son encours global de crédit). Néanmoins, GL
a continué en 2002 d’enregistrer une détérioration de la qualité de son
portefeuille avec des créances classées brutes atteignant le niveau élevé de
23,4% de l’encours global, alors que les créances classées nettes de
provisions représentaient 101% de ses fonds propres. La mise en place en 2001
d’un système de scoring pour la sélection de ses financements semble avoir
apporté une amélioration dans la qualité de la nouvelle production de GL
(ainsi seuls 6% des financements accordés en 2001 ont échoué à fin 2002 en
créances classées contre 16,9% des financements accordés en 2000).
Amen
Lease : Les indicateurs de solvabilité de AL
sont les plus faibles du secteur. AL
a subi en 2002 l’effet de la contraction de la demande de crédit et ses
marges d’intérêt, historiquement faibles du fait de sa nette inclinaison
pour les financements de montants élevés, ont continué de se rétrécir. Les
efforts de AL
pour réduire la concentration de ses risques se poursuivent, toutefois cette
concentration reste encore élevée avec les 20 plus importants risques représentant
30,5% de son encours global. La qualité des actifs de AL
s’est également détériorée en conséquence de ses engagements avec de
grandes entreprises qui ont connu en 2002 des problèmes majeurs. Les créances
classées brutes de AL
atteignent 27,1% de son encours global de crédit à fin 2002 et la couverture
par les provisions de ces créances est limitée à 31,8%. Les créances classées
nettes de provisions représentaient 198,1% des fonds propres de AL
à cette même date.
Du point de vue de Maghreb Rating, l’ensemble du secteur
du leasing est actuellement insuffisamment provisionné (le taux de couverture
des créances classées brutes par les provisions est de 38% en moyenne alors
que les 62% restants sont supposés représenter la valeur de revente sur le
marché des biens financés et/ou la valeur des garanties supplémentaires détenues)
et ces insuffisances de provisions devront être résorbées pour autoriser une
amélioration des notes attribuées aux opérateurs du secteur.
Le marché obligataire local qui constitue la principale
source de refinancement des sociétés de leasing (sauf pour TL)
a été d’un accès difficile en 2002 et les perspectives pour 2003 restent
pour le moment incertaines. Le management des sociétés de leasing estime être
à l’abri de problèmes de refinancement grâce aux lignes de crédit
revolving qui lui sont accordées par les banques tunisiennes, et aux ressources
à long terme qui lui sont proposées par des organismes financiers
internationaux ainsi que par l’Etat Tunisien. Les sociétés de leasing
comptent également sur leurs actionnaires respectifs pour souscrire à des
parts significatives de leurs prochaines émissions obligataires. Maghreb Rating
n’en considère pas moins que la liquidité de toutes les sociétés de
leasing est très tendue et que certaines sociétés ne sont pas à l’abri de
difficultés de trésorerie.
Les cinq sociétés de leasing présentent un ratio de
solvabilité supérieur au minimum prudentiel de 8% (21,2% pour TL
; 14,9% pour ATL
; 13,3% pour CIL
; 12,4% pour GL
et 10,8% pour AL)
toutefois, compte tenu de la faible qualité de leur actifs par référence aux
standards internationaux et de la concrétisation probable d’insuffisances de
provisions, leur capitalisation pourrait s’avérer moins robuste qu’il n’y
paraît.
Les banques tunisiennes accaparent une part dominante du
financement de l’économie nationale, et la contribution des sociétés de
leasing reste (après une vingtaine d’années d’existence pour la plus
ancienne) à un niveau modeste de l’ordre de 10%. Compte tenu de cette
contribution limitée au financement de l’économie nationale, Maghreb Rating
estime que les autorités tunisiennes seraient moins enclines à soutenir le
secteur du leasing s’il venait à connaître des difficultés majeures. De
plus, il est signalé que l’actionnariat de toutes les sociétés de leasing
considérées est relativement fragmenté et qu’aucune d’elles ne dispose
d’un actionnaire institutionnel détenant plus de 50% de son capital et en
mesure de la soutenir en cas de difficultés.